Le 10 septembre 2025, la Cour de Cassation a achevé la mise en conformité du droit français en matière de congés payés au droit européen sur deux points :
💊 Le salarié qui tombe malade pendant ses congés a droit au report de ces derniers à condition d’avoir notifié à l’employeur un arrêt maladie ;
Le droit européen distingue la finalité des congés payés (loisirs🌴) de celle de l’arrêt maladie (repos/guérison🤒).
⏳ Les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires des salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine ;
🔎 Concrètement, un salarié employé 35 heures qui a posé 4 jours de congés sur une semaine verra toute heure effectuée en sus de son horaire habituel le 5ème jour de la semaine rémunérée en heure supplémentaire, tenant ainsi compte de la majoration légale ou conventionnelle applicable – quand bien même il n’aura pas réellement travaillé plus de 35 heures sur la semaine considérée dans la mesure où il aura été absent.
Auparavant, si M. D aurait naturellement été rémunéré de cette heure en plus, il ne l’aurait pas été au titre du régime des heures supplémentaires, c’est à dire majorées, dans la mesure où il n’a pas effectivement travaillé plus de 35 heures sur cette semaine donnée.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Maxime SENETERRE, qui a rejoint notre équipe contentieuse en tant qu’avocat en droit social.
Fort d’une expérience solide, Maxime SENETERRE conseille et accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans leurs contentieux en droit du travail, droit pénal du travail ainsi qu’en matière d’accidents du travail, maladie professionnelle et faute inexcusable.
Bienvenue à lui !
Depuis le 23 juillet 2025, une nouvelle signalétique relative à l’interdiction de fumer est en vigueur.
Les anciens modèles d’affichage ne sont valides que jusqu’en janvier prochain⏰.
👉Pour rappel, l’employeur doit afficher un certain nombre d’informations obligatoires dans l’entreprise. L’interdiction de fumer ou encore de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif en fait partie !
📋Pensez à mettre régulièrement à jour votre affichage obligatoire !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Maître Mélina ALAMELAMA, qui a rejoint notre équipe contentieuse en tant qu’avocat en droit commercial et procédures collectives.
Mélina ALAMELAMA intervient à tous les stades précontentieux et contentieux dans les intérêts des entreprises et de leurs dirigeants, y compris en période de restructuration.
Son expertise et son expérience préalable en matière de Conseil vient consolider notre accompagnement des clients dans la gestion des dossiers ou conflits sensibles, notamment à forts enjeux financiers.
Bienvenue à elle !

Le cabinet QUINTES AVOCATS, pour son département contentieux, recherche un(e) AVOCAT(E) COLLABORATEUR(TRICE) LIBERAL(E) en droit social.
Expérience : 2 – 5 ans
Basé à Lyon et à Villefranche sur Saône, le Cabinet QUINTES AVOCATS intervient en droit social (conseil et contentieux) et contentieux des affaires.
Il se compose d’une équipe jeune et dynamique, intervenant aux côtés des entreprises et dirigeants. L’équipe est organisée en deux départements : l’un dédié au Conseil social aux entreprises, l’autre dédié au Contentieux.
Le cabinet porte une attention particulière à la formation (à destination tant de ses membres que de ses clients), au travail en équipe, et à l’expertise de ses membres dans leur domaine respectif.
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), motivé(e) et impliqué(e).
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques et procédurales, de qualités relationnelles et d’un goût pour le travail collectif / en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans un cabinet en développement, attaché à proposer une offre proactive à ses clients.
Vous disposez d’une expérience allant de 2 à 5 ans en qualité d’avocat en droit social (à dominante contentieux).
Vous serez amené(e) à traiter, en binôme, les contentieux employeur en droit social et droit de la sécurité sociale.
Possibilité de s’investir dans les projets internes du cabinet (formation notamment).
Déplacements à prévoir
Rétrocession fixe + variable à déterminer selon profil
Ouverts au télétravail
Evènements cabinet pluriannuels + formations externes et internes
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivant :
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.
Le cabinet QUINTES AVOCATS, dans le cadre du développement de son département contentieux des affaires, ouvre un poste à destination d’un(e) AVOCAT(E) COLLABORATEUR(TRICE) LIBERAL(E) en contentieux commercial et procédure collective.
Expérience : 3 – 5 ans
Qui sommes-nous ?
Basé à Lyon et à Villefranche sur Saône, le Cabinet QUINTES AVOCATS, intervient en contentieux des affaires et droit social.
Il se compose actuellement d’une équipe de 7 personnes (avocats et assistants), et de deux départements : l’un dédié au Conseil en droit social, l’autre dédié au Contentieux.
Votre profil
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), motivé(e) et impliqué(e).
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques et procédurales, de qualités relationnelles et d’un goût pour le travail en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans un cabinet dynamique et en développement.
Vous disposez d’une expérience allant de 3 à 5 ans en qualité d’avocat en droit commercial.
Vous serez amené(e) à traiter, aux côtés de Maître FLICOTEAUX, les contentieux en droit commercial / procédure collective.
Informations complémentaires
Déplacements à prévoir
Rétrocession fixe + variable à déterminer selon profil
Ouverts au télétravail
Evènements et formation cabinet pluriannuels
Contact
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivant :
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.
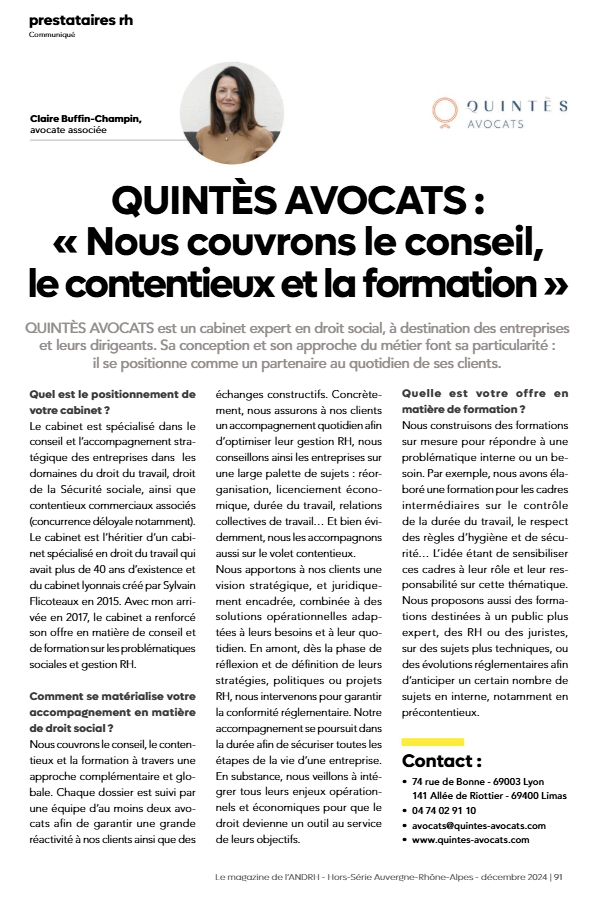
Le cabinet QUINTES AVOCATS, dans le cadre du développement de son département contentieux, recherche un(e) AVOCAT(E) COLLABORATEUR(TRICE) LIBERAL(E) en droit social.
Expérience : 3 – 5 ans
Qui sommes-nous ?
Basé à Lyon et à Villefranche sur Saône, le Cabinet QUINTES AVOCATS, intervient en droit social et contentieux des affaires.
Il se compose actuellement d’une équipe de 7 personnes (avocats et assistants), et de deux départements : l’un dédié au Conseil aux entreprises, l’autre dédié au Contentieux.
Votre profil
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), motivé(e) et impliqué(e).
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques et procédurales, de qualités relationnelles et d’un goût pour le travail en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans un cabinet dynamique et en développement.
Vous disposez d’une expérience allant de 3 à 5 ans en qualité d’avocat en droit social (à dominante contentieux).
Vous serez amené(e) à traiter, aux côtés de Maître FLICOTEAUX, les contentieux employeur en droit social et droit de la sécurité sociale.
Informations complémentaires
Déplacements à prévoir
Rétrocession fixe + variable à déterminer selon profil
Ouverts au télétravail
Evènements cabinet pluriannuels
Contact
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivant :
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.